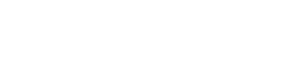Par Jade Cunot, élève en P03.
Les règles constituent un phénomène biologique naturel chez la femme et se renouvellent chaque mois. Pourtant, derrière un simple écoulement de sang se cache une longue histoire de tabous et de mythes qu’il est urgent de déconstruire.
Aujourd’hui encore, les règles soulèvent des inégalités importantes dans le monde et sont un levier dans l’amélioration de la condition de vie des femmes.
Cette semaine, un article sera publié chaque jour sur ce sujet, traité sous différents angles. Cette série d’articles est dédiée aux femmes mais aussi aux hommes car les règles, et les problèmes qu’elles soulèvent, concernent une société entière.
L’histoire des menstruations (2/5).
Les menstruations témoignent de l’histoire des femmes durant les époques. L’évolution du regard porté sur cet écoulement sanguin évolue durant les années et révèle la soumission féminine.
Avant Jésus-Christ
En 2 000 avant Jésus-Christ, on reconnaît aux femmes non seulement leur égalité avec les hommes mais surtout leur complémentarité qui s'exprime notamment lors de l'acte créateur. Les règles sont perçues alors comme des écoulements impurs mais tout de même naturels.
En 1550 av. J-C., les femmes égyptiennes plaçaient des bandes ouatées dans leur vagin et celles de la Grèce antique utilisaient des compresses enroulées autour d’un morceau de bois. Il s’agit de ce que l’on peut considérer aujourd’hui comme les ancêtres du tampon.
Au Moyen-Âge
La montée des religions change ensuite le rapport de la société aux règles. En effet, l’insertion d’un objet dans le vagin est considérée comme un péché et les règles sont taboues.
Les femmes ont donc arrêté de porter des protections et le sang coulait dans leur jupon, qui absorbait alors le flux. Quant aux femmes plus modestes, elles laissaient couler le sang le long de leur jambe et le nettoyait à l’aide d’eau.
Cette absence de protection est déjà inégalitaire selon le rang social d'autant plus que les femmes plus modestes aident, en grande partie, aux travaux des champs et ne peuvent se permettre de ne pas y travailler.
La théorie de la saignée amenée par Hippocrate dit que les règles permettent d’évacuer les déchets et impuretés de la femme. Ces mêmes impuretés et déchets que l’homme n’a pas, d’après cette théorie. La mauvaise connaissance des menstruations féminines sert à la justification de l’infériorité féminine par le sexe masculin. Les règles arrivent chaque mois pour rappeler aux femmes leur impureté, leur saleté et leur infériorité, comme un martèlement régulier de leur soumission. Les règles restent cependant un marqueur de fertilité.
Au 19e siècle, Pasteur va souligner l’importance de l’hygiène dans ses travaux. Parallèlement, l’invention de la machine à filer le coton et, donc, l’essor des sous-vêtements, vont permettre de faire avancer la vision de la propreté.
Malgré tout, la religion est encore très présente et les femmes doivent prendre des bains pendant leurs menstruations, toujours dans l’optique de se purifier.
Au 20e siècle
Leta Stetter Hollingworth, psychologue américaine et l’une des pionnières du féminisme et de la lutte pour les droits des femmes, publie en 1914 sa thèse réfutant la soi-disant fragilité des femmes.
À l'époque, elles étaient en effet considérées comme moins aptes à travailler que les hommes en raison, notamment, de leurs règles qui les handicapent une semaine par mois et leur causeraient des troubles psychologiques. Cette avancée scientifique est un premier pas vers une meilleure compréhension du corps de la femme et une redéfinition de leur statut social.
C’est en 1920 que Kimberly Clark va inventer la serviette hygiénique lavable, avant que Earl Hass invente le tampon en 1937.
Les serviettes hygiéniques lavables sont commercialisées dans les années 1920 mais elles restent peu utilisées car pas pratiques, étant des sortes de porte-jarretelles complexes. En 1963, les serviettes jetables sont commercialisées en grande surface en France.
La médecine progresse ensuite dans les années 1950 et 1960, l’origine des règles est claire. Les femmes ont de plus en plus accès à une éducation plus élevée et les mouvements féministes apparaissent… enfin !
Les tabous sur les règles sont déconstruits peu à peu mais, surtout, ces dernières ne sont plus une contrainte majeure dans la vie des femmes. Suivront des campagnes publicitaires pour des protections périodiques qui se font toujours plus diversifiées. Spéciales nuit, ultraplates, antifuites, grand flux, petit flux, …
Bien sûr, les protections périodiques sont en majorités jetables et poussent à la consommation. Les règles sont devenues un véritable business !
Au 21e siècle
Ces derniers temps, pourtant, face à notre remise en question écologique, de nouveaux types de protections montrent le bout de leur nez comme les coupes menstruelles en silicone, les culottes menstruelles ou les serviettes lavables.
Les produits chimiques contenus dans les serviettes lambdas jetables sont très mauvais pour notre santé et on y retrouve même, dans certaines, des perturbateurs endocriniens nocifs pour la fertilité mais également du glyphosate, une substance cancérigène.
Le tabou des règles n’est pas complétement levé : on notera le liquide bleu dans les publicités pour les représenter, la persistance à croire que les règles sont sales ou encore la gêne de certaines femmes lorsqu’elles sortent une serviette discrètement de leur sac comme s’il s’agissait de ne surtout pas heurter la vue d’autrui. Néanmoins, le progrès est important.
En résumé
L’histoire des menstruations reflète celle des femmes et l’amélioration de leur place dans la société. Des siècles de méconnaissance ont alimenté les mythes autour des règles impactant les femmes.
Aujourd’hui, nous sommes davantage au courant de l’origine des menstruations. Pourtant, les préjugés ont la vie dure et c’est à nous de les déconstruire.